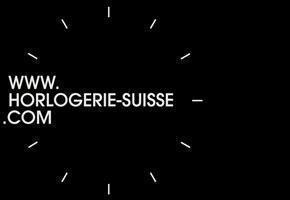

Par Pascal Brandt
Créateurs horlogers et Salon(s) : la politique de l’air du temps
 Le Salon de Bâle est pour demain.
Le Salon de Bâle est pour demain.
La grande nouveauté de l’événement cette année est symbolisée par The Watch Factory. Initié par le journaliste spécialisé Grégory Pons en étroite collaboration avec la direction de Basel, cet espace est dédié à une sélection de 12 marques de créateurs horlogers purs, symboles et représentants de cette tendance qualifiée de « nouvelle horlogerie » née dans les dernières années d’euphorie, mais dont l’un des précurseurs demeure historiquement Alain Silberstein.
Que lire dans cette initiative ?
Tout d’abord qu’elle colle parfaitement à l’air du temps et y trouve sa pleine justification. Tout ce petit monde se retrouvera au cœur d’un espace propre durant le Salon bâlois, dans un environnement en ligne avec l’esprit alchimique guidant des créateurs dont la volonté, pour nombre d’entre eux, entend bousculer les canons d’une horlogerie qui leur paraît figée et statique.
The Watch Factory consacre la réalité d’une vraie tendance appelée à durer. En corollaire, elle confère un statut à des créateurs et des sociétés qui, si ils existent par des produits, sont toutefois demeurés jusqu’à aujourd’hui pour plusieurs d’entre eux des non-marques. Et l’on sait combien le branding et ses valeurs de réassurance sont essentielles, à plus forte raison en période de tassement.
Au-delà de ce constat, mon intérêt se porte sur un autre bout de la lorgnette. Et si l’on essayait de jauger la portée réelle de ce micro-salon au-delà de son aspect strictement horloger en le replaçant dans un environnement élargi ?
Mesuré à l’aune des deux rendez-vous horlogers suisses, voilà qui ouvre des perspectives et matière à réflexion… Flashback .
BASEL et le SIHH ont, cahin-caha, trouvé au fil des ans un modus vivendi, l’un suivant directement l’autre et permettant à la distribution d’avaler d’une traite visites et rendez-vous entre Rhône et Rhin. Dès cette année toutefois, la rupture du gentleman’s agreement a de facto volé en éclat, avec un SIHH qui n’avait d’autre choix que de se tenir en janvier.
Qu’a-t-on constaté ? En marge des marques participantes au SIHH, une nuée de maisons se sont progressivement greffées en parallèle dans la périphérie du Salon pour investir les hôtels genevois. Cette année, ils étaient une multitude à capter la clientèle conviée au SIHH, nouvelles et jeunes compagnies de créateurs que l’on retrouve pour une part dans l’espace que Bâle leur a réservé. Sans même parler des marques établies de l’axe Genève/La Chaux-de-Fonds/Bienne, qui furetaient elles aussi à un jet de pierre de Palexpo.
Rien que de très normal et naturel à cette situation aux allures de phagocytage sauvage. Il met en exergue un double constat.
D’une part, il apparaît assez clairement que le SIHH atteint désormais un plafond ou un seuil (c’est à choix), et n’a d’autre possibilité que de prendre acte du phénomène. S’ouvrir plus largement ? Si tel devait être le cas, cela le serait d’une certaine manière sous la contrainte, mais remettrait en question les fondements conceptuels qui ont conduit à sa création par le groupe Richemont.
Autres temps, autres mœurs : l’horlogerie mute et évolue, les enjeux d’hier ne sont plus nécessairement les mêmes que ceux de la décennie précédente.
D’autre part, force est d’admettre que BASEL fait preuve d’une grande finesse tactique. Avec la mise à disposition d’un espace dédié à The Watch Factory, l’organisation du Salon se positionne comme celle qui, en « récupérant » quelques-unes des sociétés représentantes de l’ultra-niche, démontre que l’événement rhénan demeure incontestablement la vitrine la plus représentative de l’ensemble de l’horlogerie, de tous les positionnements et tendances qui l’animent.
La naissance de The Watch Factory, en plus d’être acte d’intelligence, témoigne à coup sûr d’une dimension politique certaine.
©
toute reproduction strictement interdite